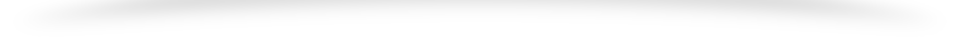Il y a des siècles, l’Afrique était un phare de savoir.
L’Égypte antique, par exemple, a illuminé le monde par ses recherches astronomiques, mathématiques, philosophiques et spirituelles.
Mais cette flamme s’est peu à peu éteinte, consumée par les invasions, les colonisations, et surtout, par l’absence d’institutions pérennes capables de conserver et transmettre ces trésors immatériels.
Aujourd’hui, l’Afrique reste un continent paradoxal :
– Béni par la nature
– Regorgeant de minerais précieux
– Doté d’un climat enviable
… et pourtant incapable de nourrir tous ses enfants ou de leur offrir des conditions de vie dignes.
Comme un gigantesque coffre au trésor dont la clé se serait perdue.
Dans ce contexte, un phénomène encore plus insidieux que les conquêtes et les pillages physiques s’installe : la captation numérique des savoirs endogènes.
Les réseaux sociaux et TikTok en particulier sont devenus de véritables filets à papillons, capturant à la volée nos danses ancestrales, nos recettes médicinales, nos rites initiatiques, nos contes et proverbes.
Une fois capturés, ces savoirs sont projetés dans un espace globalisé et uniformisé, où ils se consomment à la vitesse d’un swipe… et perdent aussitôt leur essence profonde.
Bien sûr, TikTok donne une visibilité inédite aux cultures africaines. Mais à quel prix ?
Ce qui devait être un partage devient souvent une dilution, voire un vol silencieux.
Une tradition qui traversait des générations, transmise dans le couvent, la case du sage, le cercle du village, se retrouve réduite à une courte vidéo soumise aux likes, aux tendances, et aux algorithmes.
Le savoir, jadis sacré, devient un divertissement éphémère.
Pire encore, l’Afrique n’a pas construit de « université des savoirs endogènes » où ces connaissances pourraient être archivées, étudiées, développées et protégées.
Aucun grand centre de documentation digne de ce nom pour recueillir les recherches du passé et en inspirer d’autres.
Ce vide est comblé par le numérique, mais à sa manière : superficielle et volatile.
Et pendant que nous dansons devant les écrans, nos jeunes esprits les plus brillants, formés grâce à des bourses étrangères, s’envolent vers l’Occident, attirés par de meilleures conditions de vie.
Ils ne reviennent pas, laissant derrière eux un continent qui peine à transformer ses richesses en prospérité.
Ainsi, le cercle vicieux continue : exportation des talents, importation de contenus vides, acculturation progressive.
Quand viendra le véritable développement de l’Afrique ?
Ce ne sera pas seulement lorsque nous aurons des routes ou des gratte-ciel.
Ce sera le jour où nous aurons bâti nos propres lieux de savoir, physiques et numériques, protégés des logiques mercantiles et algorithmiques.
Le jour où nos enfants apprendront d’abord à écouter la voix de leurs ancêtres avant celle des « trends ».
L’Afrique a déjà tout pour redevenir un paradis terrestre. Il ne lui manque qu’une seule chose : reprendre le contrôle sur ce qui fait son âme… son savoir.
Eric Gbèha, acteur culturel